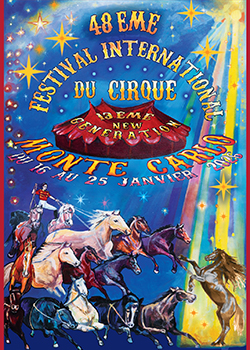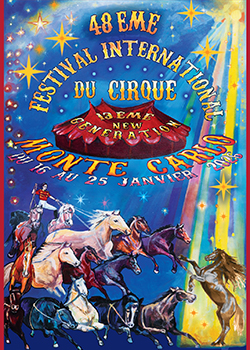Soirées "L’Étrange musique"

Le Bunker de la dernière rafale de Jeunet & Caro © DR (droits réservés).
La partition musicale, élément indispensable de l’image en mouvement depuis l’invention du cinéma muet, passe souvent inaperçue à bien des spectateurs. Ce ne sera pas le cas lors des deux soirées qui lui sont tout particulièrement consacrées.
Le 6 septembre, impossible d’échapper à Marc Caro, qui vient jouer en live la nouvelle composition sonore de son mythique Bunker de la dernière rafale, coréalisé en 1981 avec son complice d’alors Jean-Pierre Jeunet, pas plus qu’au groupe underground californien Tuxedomoon, qui s’attaque lui aux images très "Gay kitsch seventies" du Pink Narcissus de James Bidgood.
Même punition le 7 septembre où le furieusement allumé Boyd Rice - il est entre autres révérend de "l’Église de Satan"… — entreprend de dynamiter nos oreilles, en même temps que le cultissime et surréaliste Dementia Daughter of Horrors, réalisé à l’aide d’on ne sait quelles substances hallucinogènes par John Parker en 1955. Les acouphènes et les éléphants roses en cuir clouté sont compris dans le prix du billet.
Le 6 septembre, impossible d’échapper à Marc Caro, qui vient jouer en live la nouvelle composition sonore de son mythique Bunker de la dernière rafale, coréalisé en 1981 avec son complice d’alors Jean-Pierre Jeunet, pas plus qu’au groupe underground californien Tuxedomoon, qui s’attaque lui aux images très "Gay kitsch seventies" du Pink Narcissus de James Bidgood.
Même punition le 7 septembre où le furieusement allumé Boyd Rice - il est entre autres révérend de "l’Église de Satan"… — entreprend de dynamiter nos oreilles, en même temps que le cultissime et surréaliste Dementia Daughter of Horrors, réalisé à l’aide d’on ne sait quelles substances hallucinogènes par John Parker en 1955. Les acouphènes et les éléphants roses en cuir clouté sont compris dans le prix du billet.
The Theatre Bizarre

Udo Kier, "Monsieur Loyal" dans The Theatre Bizarre © DR (droits réservés).
Le théâtre parisien du Grand Guignol, qui anima les soirées de la rue Chaptal de 1897 à 1963, a souvent été source d’inspiration ou d’hommage pour le cinéma, à commencer chez Herschell Gordon Lewis, le pape et inventeur du film gore.
La référence est ici directe, puisque c’est un théâtre de pantins en effet très bizarre qui sert de "liant" aux segments de ce film à sketches franco-américain. Et si la première histoire, La mère des crapauds, réalisé par un jadis plus inspiré Richard Stanley (Hardware), où un jeune couple d’américains en vacances en France tombe sur un exemplaire du mythique Necronomicon - au passage, on se demande bien comment le grimoire imaginé par H.P. Lovecraft a atterri dans nos contrées et en quoi il passionne ces touristes au point de se perdre en forêt pour le consulter… -, renvoie plus à l’univers du cinéma d’horreur italien des années 70/80, le reste du métrage évoque bien le Grand Guignol, période Max Maurey et André de Lorde.
Qu’il s’agisse du couple en rupture de I Love You, de Buddy Giovinazzo, de celui guère plus soudé du délirant Wet Dreams de Tom Savini, ou encore de la tueuse en série qui sévit dans Vision Stains de Karim Hussain - sans doute le segment le plus surprenant du lot -, il est beaucoup question de folie et de sérieux dérèglements psychologiques, humour noir et effets sanglants gratinés à l’appui. Quant au "Monsieur Loyal" de l’ensemble, il est incarné par un Udo Kier dont le regard halluciné n’aurait pas dépareillé sur la scène du regretté théâtre de l’horreur.
La référence est ici directe, puisque c’est un théâtre de pantins en effet très bizarre qui sert de "liant" aux segments de ce film à sketches franco-américain. Et si la première histoire, La mère des crapauds, réalisé par un jadis plus inspiré Richard Stanley (Hardware), où un jeune couple d’américains en vacances en France tombe sur un exemplaire du mythique Necronomicon - au passage, on se demande bien comment le grimoire imaginé par H.P. Lovecraft a atterri dans nos contrées et en quoi il passionne ces touristes au point de se perdre en forêt pour le consulter… -, renvoie plus à l’univers du cinéma d’horreur italien des années 70/80, le reste du métrage évoque bien le Grand Guignol, période Max Maurey et André de Lorde.
Qu’il s’agisse du couple en rupture de I Love You, de Buddy Giovinazzo, de celui guère plus soudé du délirant Wet Dreams de Tom Savini, ou encore de la tueuse en série qui sévit dans Vision Stains de Karim Hussain - sans doute le segment le plus surprenant du lot -, il est beaucoup question de folie et de sérieux dérèglements psychologiques, humour noir et effets sanglants gratinés à l’appui. Quant au "Monsieur Loyal" de l’ensemble, il est incarné par un Udo Kier dont le regard halluciné n’aurait pas dépareillé sur la scène du regretté théâtre de l’horreur.
Revenge : A Love Story

© DR (droits réservés).
Le titre du film de Ching-Po Wong ne trompe pas sur la marchandise : il s’agit bien d’une histoire d’amour et de vengeance. Celle de deux exclus du miracle chinois, un vendeur de rue que tous surnomment "petit bâtard" et une retardée mentale, confrontés à une bande de flics sans scrupules. Après avoir vécu le pire entre leurs mains, "petit bâtard" leur réserve un retour de manivelle à la hauteur du cauchemar subi. Jouant en permanence sur les contraires - émotion/dégoût, poésie/sordide, élégance de la réalisation/violence des situations -, Ching-Po Wong compose un film aussi poignant que percutant, qui, tout en louchant ostensiblement du côté de la concurrence sud-coréenne, ressuscite les grandes heures du cinéma-choc de Hong Kong.
Nuit Suhi Typhoon

Dead Ball © DR (droits réservés).
Sushi Typhoon n’est pas le nom du dernier fast-food pour branchés japonisants, mais celui du label créé récemment par la vénérable Nikkatsu, l’une des plus vieilles major nippones - elle a été fondée en 1912. But de la manœuvre : développer les scénarii les plus imaginatifs et permettre à des réalisateurs sans complexes de les porter à l’écran, le tout pour le prix d’une planche de sushis, justement.
Résultat, des films gravement atteints, comme on peut le constater par exemple avec Dead Ball - un jeune champion de base-ball à l’allure de héros de manga doit affronter, dans une prison dirigée par une admiratrice du IIIe Reich, une équipe de joueuses psychopathes - ou, mieux encore, avec Hell Driver, qui nous transporte dans un japon partagé entre zombies extraterrestres et survivants plus ou moins mutants. C’est trash, gore, sans tabou, volontiers cartoonesque, au-delà de l’excessif, et très certainement destiné à aider les jeunes japonais à supporter les tonnes de carcans sociaux qui pèsent sur leurs épaules.
Résultat, des films gravement atteints, comme on peut le constater par exemple avec Dead Ball - un jeune champion de base-ball à l’allure de héros de manga doit affronter, dans une prison dirigée par une admiratrice du IIIe Reich, une équipe de joueuses psychopathes - ou, mieux encore, avec Hell Driver, qui nous transporte dans un japon partagé entre zombies extraterrestres et survivants plus ou moins mutants. C’est trash, gore, sans tabou, volontiers cartoonesque, au-delà de l’excessif, et très certainement destiné à aider les jeunes japonais à supporter les tonnes de carcans sociaux qui pèsent sur leurs épaules.
The Woman

© DR (droits réservés).
Nouveau film de Lucky McKee (May et l’épisode Sick Girl de la série Masters of Horrors) après les mésaventures de The Woods - remonté par la production) - et de Red - viré en plein tournage et remplacé par le norvégien Trygve Allister Diesen -, The Woman nous plonge sans ménagement dans l’univers très américain de Jack Ketchum, l’écrivain le plus dérangeant du moment, mais aussi, l’un ne va pas sans l’autre, le plus controversé.
Il faut dire que Ketchum n’a pas son pareil pour faire fondre à l’acide le masque anodin de l’Amérique moyenne propre sur elle et bien pensante, pour révéler ce qu’elle peut cacher de plus révoltant. Ici, le père, figure centrale de la famille middle-class et membre honorable de la communauté. En réalité, un salopard pervers, qui frappe sa femme soumise, engrosse sa fille et éduque son fils à suivre ces saines traditions. Quand il ramène d’une partie de chasse en forêt une "femme sauvage" dans le but de l’éduquer aux bonnes mœurs, le massacre peut commencer…
Présenté en avant-première au très propret également festival de Sundance, The Woman a fait fuir quelques spectateurs outrés au milieu de la projection. Rien d’étonnant. Lucky McKee n’est pas un réalisateur confortable et son étroite collaboration avec Jack Ketchum — ils ont écrit le scénario ensemble — ne pouvait qu’occasionner des éclaboussures pas forcément ragoûtantes. En revanche, accuser ce film, comme cela fut fait, d’offrir une image dégradante de la femme, c’est être à côté de la plaque. Ou, plus précisément, accuser le miroir du reflet qu’il nous renvoie.
Il faut dire que Ketchum n’a pas son pareil pour faire fondre à l’acide le masque anodin de l’Amérique moyenne propre sur elle et bien pensante, pour révéler ce qu’elle peut cacher de plus révoltant. Ici, le père, figure centrale de la famille middle-class et membre honorable de la communauté. En réalité, un salopard pervers, qui frappe sa femme soumise, engrosse sa fille et éduque son fils à suivre ces saines traditions. Quand il ramène d’une partie de chasse en forêt une "femme sauvage" dans le but de l’éduquer aux bonnes mœurs, le massacre peut commencer…
Présenté en avant-première au très propret également festival de Sundance, The Woman a fait fuir quelques spectateurs outrés au milieu de la projection. Rien d’étonnant. Lucky McKee n’est pas un réalisateur confortable et son étroite collaboration avec Jack Ketchum — ils ont écrit le scénario ensemble — ne pouvait qu’occasionner des éclaboussures pas forcément ragoûtantes. En revanche, accuser ce film, comme cela fut fait, d’offrir une image dégradante de la femme, c’est être à côté de la plaque. Ou, plus précisément, accuser le miroir du reflet qu’il nous renvoie.
Une soirée avec Rutger Hauer

Rutger Hauer © DR (droits réservés).
Le 10 septembre, l’acteur fétiche de Paul Verhoeven présente en personne deux chefs d’œuvres. La Chair et le sang (1985), d’abord, première réalisation américaine du "hollandais violent". Cette furie post-médiévale - nous sommes à la charnière entre le Moyen-âge et la Renaissance, entre les ténèbres et la lumière, entre l’obscurantisme religieux et la connaissance scientifique -, dans laquelle le mercenaire Rutger Hauer s’entiche de la très troublante et manipulatrice Jennifer Jason Leigh, détourne avec brio tous les clichés du film de chevalerie, pour construire un échafaudage d’ambiguïté qui pervertit les notions classiques du bien et du mal.
Rutger Hauer retrouvera Jennifer Jason Leigh en 1987 dans Hitcher, de Robert Harmon, mais pour lui faire passer un très sale quart d’heure, cette fois. Auto-stoppeur un brin psychopathe, il chasse le conducteur solitaire et imprudent sur les routes désertiques américaines. Road-movie éprouvant, Hitcher demeure à ce jour la seule réalisation vraiment convaincante de Robert Harmon, qui enchaînera ensuite les téléfilms anodins. Raison de plus pour ne pas s’en priver.
Rutger Hauer retrouvera Jennifer Jason Leigh en 1987 dans Hitcher, de Robert Harmon, mais pour lui faire passer un très sale quart d’heure, cette fois. Auto-stoppeur un brin psychopathe, il chasse le conducteur solitaire et imprudent sur les routes désertiques américaines. Road-movie éprouvant, Hitcher demeure à ce jour la seule réalisation vraiment convaincante de Robert Harmon, qui enchaînera ensuite les téléfilms anodins. Raison de plus pour ne pas s’en priver.
Du 2 au 11 septembre 2011.
L’Étrange festival.
Forum des images, Forum des Halles, Paris 1er.
Programmation complète, horaires et soirées spéciales sur www.etrangefestival.com
Renseignements et réservations au 01 44 76 63 00.
Vente en ligne des billets sur www.forumdesimages.fr
L’Étrange festival.
Forum des images, Forum des Halles, Paris 1er.
Programmation complète, horaires et soirées spéciales sur www.etrangefestival.com
Renseignements et réservations au 01 44 76 63 00.
Vente en ligne des billets sur www.forumdesimages.fr