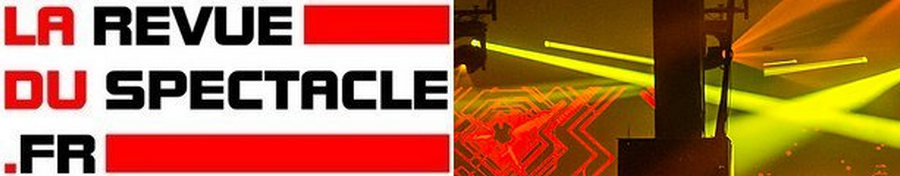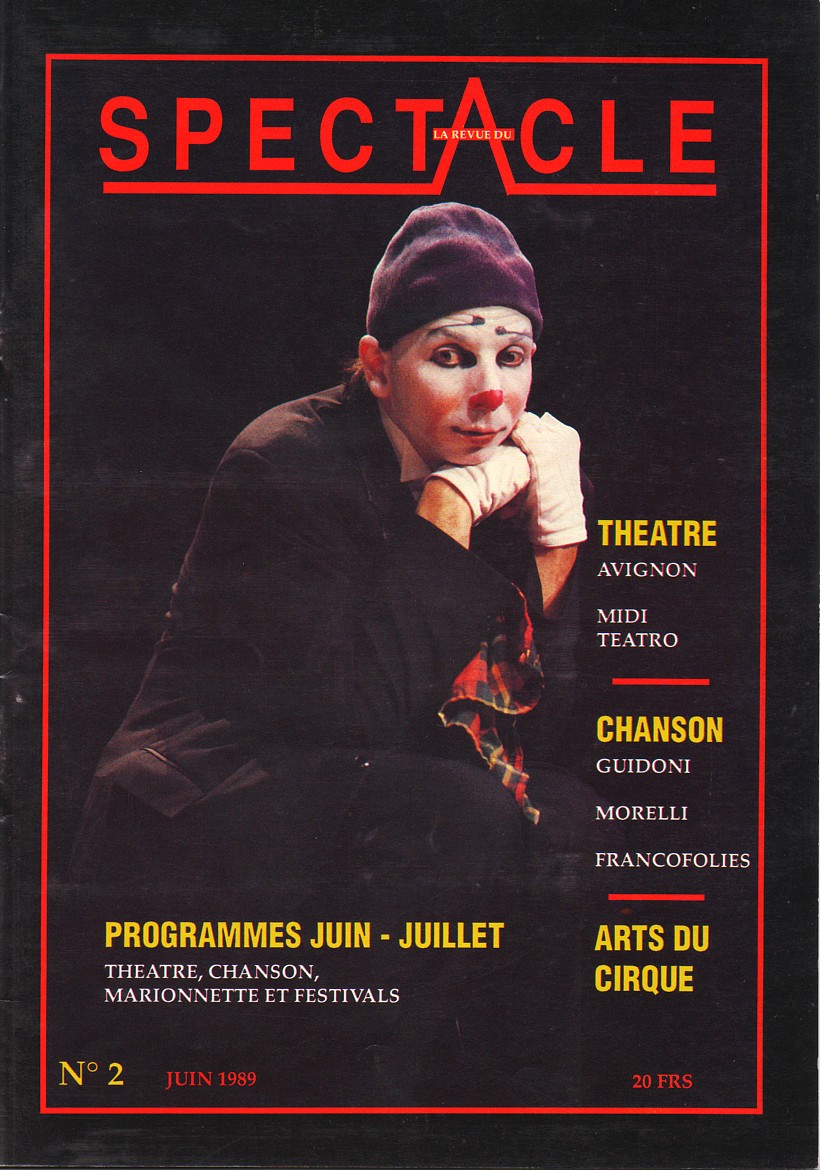Fossilisés par une culture d'État les ayant accaparés, ces "maîtres anciens" serviles hantent de leur présence-absence le Musée d'art ancien de Vienne où un vieux critique musical vient compulsivement s'asseoir, "tous les deux jours, sauf le lundi, depuis plus de trente ans", pour contempler "L'homme à la barbe blanche" de Tintoret… Tel est ici l'argument de départ donnant lieu à des saillies qui, au-delà de leur folle drôlerie (le sous-titre "Comédie" nous en avertit) ouvre à une vraie réflexion sur l'art et ses avatars.
Rendant compte par le menu des pensées et gestes en boucle de l'antique critique en musicologie, Nicolas Bouchaud égal à lui-même – lire transcendant – parcourt d'une seule traite ce roman fleuve pour en exprimer, comme on exprime le jus d'un fruit, toute la quintessence. Se coulant à la perfection dans le personnage dont il endosse les tics répétitifs, c'est en état de grâce artistique qu'il délivre mot à mot, phrase à phrase, page à page, le flux et reflux d'une pensée déferlante où la répétition du même a valeur de ponctuation, et où les fragments de nos vies minuscules font effraction dans la cour des soi-disant grands hommes.
Alors que les derniers spectateurs viennent de prendre place, le comédien assis en bord de travée scrute la salle pour lancer à son adresse : "Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué ici ? Je vous le dirai, mais laissez-moi le temps…". D'emblée, la connivence acteur-spectateurs est établie et, durant l'heure et demie qui suivra, elle ne sera jamais rompue tant l'attraction opère, faisant de nous "les victimes – ô combien consentantes – du maître en logorrhée musicologique".
Rendant compte par le menu des pensées et gestes en boucle de l'antique critique en musicologie, Nicolas Bouchaud égal à lui-même – lire transcendant – parcourt d'une seule traite ce roman fleuve pour en exprimer, comme on exprime le jus d'un fruit, toute la quintessence. Se coulant à la perfection dans le personnage dont il endosse les tics répétitifs, c'est en état de grâce artistique qu'il délivre mot à mot, phrase à phrase, page à page, le flux et reflux d'une pensée déferlante où la répétition du même a valeur de ponctuation, et où les fragments de nos vies minuscules font effraction dans la cour des soi-disant grands hommes.
Alors que les derniers spectateurs viennent de prendre place, le comédien assis en bord de travée scrute la salle pour lancer à son adresse : "Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué ici ? Je vous le dirai, mais laissez-moi le temps…". D'emblée, la connivence acteur-spectateurs est établie et, durant l'heure et demie qui suivra, elle ne sera jamais rompue tant l'attraction opère, faisant de nous "les victimes – ô combien consentantes – du maître en logorrhée musicologique".
Jeux de miroirs entre l'acteur, contemplant de dos une série de toiles blanches où, sur l'une d'entre elles, on peut imaginer entrevoir "L'homme à la barbe blanche" de Tintoret, et nous, nous projetant dans son regard magnétique tant la vérité se donne à voir dans le tourbillon des fragments qui la composent. Une expérience étourdissante, au propre comme au figuré, où l'on perd pied pour mieux se dessaisir des interprétations manufacturées conduisant à une lecture fossilisée des enjeux de l'art vivant.
Du magma fusionnant les considérations sur la récupération par l'État des artistes "normalisés", à l'insu de leur plein gré, avec les épreuves des deuils imposés par le fait même de vivre, la pensée fuse faisant corps avec celui de l'acteur l'incarnant. Ainsi, mises en mouvement, les réflexions nous atteignent par vagues successives, aussi imprévisibles qu'impétueuses, propres à nous laver de tous "pré-jugés". Comme on pourra en juger par ces quelques morceaux choisis extraits de ce bouillon de cultures revisitées…
Stifter, ce grand maître de la prose vénéré par toute l'élite autrichienne ? Un plumitif minable, un bavard insupportable au style mal fichu, l'auteur en vérité le plus ennuyeux et le plus hypocrite de la littérature allemande, d'une sentimentalité et d'une lourdeur petite-bourgeoise, un pédagogue à l'odeur de moisi… Heidegger, ce philosophe de la Forêt Noire ? Un ridicule petit-bourgeois national-socialiste en culotte de golf, un faible penseur préalpin, un ruminant philosophe foncièrement allemand… Beethoven, cet éminent représentant du classicisme viennois ? Un dépressif chronique, le compositeur d'État par excellence, compositeur plus de tintamarre que de musique, expert de la marche à pas cadencés des notes… Mahler ? Une aberration, le type du compositeur à la mode provoquant l'hystérie de masse, bien plus mauvais encore que Bruckner avec lequel il partage le même kitsch…
Du magma fusionnant les considérations sur la récupération par l'État des artistes "normalisés", à l'insu de leur plein gré, avec les épreuves des deuils imposés par le fait même de vivre, la pensée fuse faisant corps avec celui de l'acteur l'incarnant. Ainsi, mises en mouvement, les réflexions nous atteignent par vagues successives, aussi imprévisibles qu'impétueuses, propres à nous laver de tous "pré-jugés". Comme on pourra en juger par ces quelques morceaux choisis extraits de ce bouillon de cultures revisitées…
Stifter, ce grand maître de la prose vénéré par toute l'élite autrichienne ? Un plumitif minable, un bavard insupportable au style mal fichu, l'auteur en vérité le plus ennuyeux et le plus hypocrite de la littérature allemande, d'une sentimentalité et d'une lourdeur petite-bourgeoise, un pédagogue à l'odeur de moisi… Heidegger, ce philosophe de la Forêt Noire ? Un ridicule petit-bourgeois national-socialiste en culotte de golf, un faible penseur préalpin, un ruminant philosophe foncièrement allemand… Beethoven, cet éminent représentant du classicisme viennois ? Un dépressif chronique, le compositeur d'État par excellence, compositeur plus de tintamarre que de musique, expert de la marche à pas cadencés des notes… Mahler ? Une aberration, le type du compositeur à la mode provoquant l'hystérie de masse, bien plus mauvais encore que Bruckner avec lequel il partage le même kitsch…
S'entremêlant à ces portraits au vitriol visant à désacraliser ce que l'art sanctuarisé et ses serviteurs zélés peuvent représenter de forces réactionnaires, des considérations sur les toilettes viennoises dégoûtantes – les Autrichiens étant incultes en matières… de toilettes – voisinent avec des remarques à l'emporte-pièce sur les historiens d'art bêlant devant des troupeaux de moutons au regard vide. Quant aux enseignants, ces profs rabougris, petits-bourgeois cadenassés dans leurs certitudes apprises, empêcheurs de vivre, suppôts de l'État, ils dégoûtent à jamais les enfants autant des musées que de l'existence qu'ils abîment en eux.
Tableaux peu reluisants s'il en est d'un État catholique post national-socialiste, destructeur des forces de vie, mais brossés avec tant de frénésie vitale que ce qui ressort, derrière les charges des plus appuyées, c'est le bonheur hautement contagieux d'entendre et de voir ce pourfendeur – certes névrosé à l'excès, mais aussi excessivement lucide – d'un système porteur d'une morbidité avérée, rayonner d'humanité vibrante. L'incarnation par l'acteur, revêtant à l'occasion la culotte de peau de l'archétype autrichien, rend encore plus savoureuse la "comédie" humaine ayant trouvé là refuge sur un plateau de théâtre.
Tableaux peu reluisants s'il en est d'un État catholique post national-socialiste, destructeur des forces de vie, mais brossés avec tant de frénésie vitale que ce qui ressort, derrière les charges des plus appuyées, c'est le bonheur hautement contagieux d'entendre et de voir ce pourfendeur – certes névrosé à l'excès, mais aussi excessivement lucide – d'un système porteur d'une morbidité avérée, rayonner d'humanité vibrante. L'incarnation par l'acteur, revêtant à l'occasion la culotte de peau de l'archétype autrichien, rend encore plus savoureuse la "comédie" humaine ayant trouvé là refuge sur un plateau de théâtre.
D'autres épisodes plus personnels, comme celui de l'enfance malheureuse à conjurer, ou comme celui du deuil impossible de la femme aimée, rencontrée justement devant ce fameux tableau de Tintoret, font effraction comme des bulles d'oxygène venant crever à la surface de sa mémoire tourmentée. Affres trouvant in fine dans l'art le lieu de la consolation ultime, car même si Shakespeare et Kant nous laissent en plan lorsque l'on aurait besoin d'eux, Schopenhauer peut devenir un médicament de survie. Quant aux gens, même si légitimement on aurait toutes les raisons de les détester, nous voulons vivre avec eux parce que c'est l'unique chance que nous ayons de survivre… sans devenir fous.
Quant à la chute – la raison pour laquelle le vieux critique de musique nous a invités ce jour-là au Musée d'art ancien –, elle donnera lieu à deux billets… offerts ici par Nicolas Bouchaud pour "partager le plaisir de cette folie perverse" qu'est le théâtre en allant découvrir prochainement au Théâtre 14 "Être peintre" d'après la correspondance de Nicolas de Staël.
De cette comédie au parfum tragique, on ressort rassérénés, voire carrément heureux… En effet, au cœur de la noirceur de l'univers dépeint avec une férocité joyeuse par Thomas Bernhard, se lovent des moments de pur émerveillement transcendant pour la magnifier la lucidité du regard nihiliste. Quant au rôle superbement interprété par Nicolas Bouchaud, définitivement "maître ès-arts", il amplifie le bonheur offert par ces "Maîtres Anciens".
Vu le samedi 9 décembre 2023 au Théâtre 14, Paris 14e.
Quant à la chute – la raison pour laquelle le vieux critique de musique nous a invités ce jour-là au Musée d'art ancien –, elle donnera lieu à deux billets… offerts ici par Nicolas Bouchaud pour "partager le plaisir de cette folie perverse" qu'est le théâtre en allant découvrir prochainement au Théâtre 14 "Être peintre" d'après la correspondance de Nicolas de Staël.
De cette comédie au parfum tragique, on ressort rassérénés, voire carrément heureux… En effet, au cœur de la noirceur de l'univers dépeint avec une férocité joyeuse par Thomas Bernhard, se lovent des moments de pur émerveillement transcendant pour la magnifier la lucidité du regard nihiliste. Quant au rôle superbement interprété par Nicolas Bouchaud, définitivement "maître ès-arts", il amplifie le bonheur offert par ces "Maîtres Anciens".
Vu le samedi 9 décembre 2023 au Théâtre 14, Paris 14e.
"Maîtres anciens (Comédie)"
Texte : Thomas Bernhard,
Un projet de Nicolas Bouchaud.
Mise en scène : Éric Didry.
Traduction française : Gilberte Lambrichs (publiée aux Éditions Gallimard).
Adaptation : Véronique Timsit, Nicolas Bouchaud, Éric Didry.
Avec : Nicolas Bouchaud.
Collaboration artistique : Véronique Timsit.
Scénographie et costumes : Élise Capdenat, Pia de Compiègne.
Lumière : Philippe Berthomé, en collaboration avec Jean-Jacques Beaudouin.
Son : Manuel Coursin.
Voix : Judith Henry.
Régie générale, régie son : Ronan Cahoreau-Gallier.
Durée : 1 h 30.
Représenté du 5 au 23 décembre 2023,
au Théâtre 14, 20, avenue Marc Sangnier, Paris 14e.
Tournée
Du 10 au 12 janvier 2024 : Théâtre des 13 vent - CDN, Montpellier (34).
Un projet de Nicolas Bouchaud.
Mise en scène : Éric Didry.
Traduction française : Gilberte Lambrichs (publiée aux Éditions Gallimard).
Adaptation : Véronique Timsit, Nicolas Bouchaud, Éric Didry.
Avec : Nicolas Bouchaud.
Collaboration artistique : Véronique Timsit.
Scénographie et costumes : Élise Capdenat, Pia de Compiègne.
Lumière : Philippe Berthomé, en collaboration avec Jean-Jacques Beaudouin.
Son : Manuel Coursin.
Voix : Judith Henry.
Régie générale, régie son : Ronan Cahoreau-Gallier.
Durée : 1 h 30.
Représenté du 5 au 23 décembre 2023,
au Théâtre 14, 20, avenue Marc Sangnier, Paris 14e.
Tournée
Du 10 au 12 janvier 2024 : Théâtre des 13 vent - CDN, Montpellier (34).