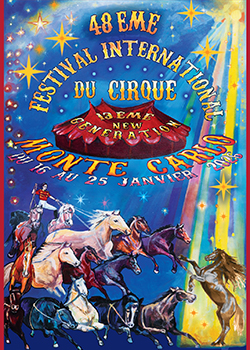Exilé aux États-Unis depuis 1939 et fait citoyen américain en 1945, Igor Stravinski, l'éternel errant, prend acte en s'installant à Hollywood du nouvel ordre mondial et culturel. Son ouvrage le plus long (2 h 30) et premier opéra en langue anglaise, "The Rake's Progress" (La Carrière du Libertin"), peut faire l'objet d'une double lecture : en apparence un ouvrage qui ferme le ban à la période néo-classique du compositeur avec ses références à des opéras des ères baroque et classique, mais qui peut aussi se lire comme le bilan désenchanté voire angoissé d'un compositeur de soixante-dix ans, que les dodécaphonistes - tel Arnold Schönberg son voisin en Californie - ont ringardisé.
Le séducteur raté Tom Rakewell est donc tout autant un personnage inspiré par la série d'estampes de William Hogarth au XVIIIe siècle sur le thème du Libertin, qu'une possible projection du compositeur lui-même.
Conseillé par son autre voisin à Hollywood, l'écrivain Aldous Huxley, Stravinski choisit le poète W. H. Auden pour le livret, qui collaborera avec C. S. Kallman. Ils créeront deux personnages qu'on ne trouve pas dans les gravures apologétiques de Hogarth : Nick Shadow (ce personnage diabolique qui permet l'introduction d'un pacte faustien dans l'intrigue) et Ann Trulove, l'amoureuse pure de Tom. L'histoire se décline en neuf tableaux tantôt bouffons tantôt sarcastiques ou lyriques. On y suit la trajectoire de Tom Rakewell qui tombe de Charybde en Scylla.
Le séducteur raté Tom Rakewell est donc tout autant un personnage inspiré par la série d'estampes de William Hogarth au XVIIIe siècle sur le thème du Libertin, qu'une possible projection du compositeur lui-même.
Conseillé par son autre voisin à Hollywood, l'écrivain Aldous Huxley, Stravinski choisit le poète W. H. Auden pour le livret, qui collaborera avec C. S. Kallman. Ils créeront deux personnages qu'on ne trouve pas dans les gravures apologétiques de Hogarth : Nick Shadow (ce personnage diabolique qui permet l'introduction d'un pacte faustien dans l'intrigue) et Ann Trulove, l'amoureuse pure de Tom. L'histoire se décline en neuf tableaux tantôt bouffons tantôt sarcastiques ou lyriques. On y suit la trajectoire de Tom Rakewell qui tombe de Charybde en Scylla.
Amoureux dans une première scène bucolique tel un héros de Monteverdi (l'ouverture de style baroque cite clairement "Orfeo"), Tom fait un vœu différent à chaque acte qui accélère sa chute et sa dépravation en le menant de la chaumière de sa fiancée à une maison close en ville puis à une résidence de luxe : "Je veux être riche" à l'acte I, "Je veux être heureux" à l'acte II - vœux qui font se matérialiser un être mystérieux prêt à se mettre à son service pour mieux l'asservir, Nick Shadow.
Finalement ruiné, corrompu moralement et ne se sentant plus digne d'Ann Trulove qui ne l'a pas abandonné malgré ses errements, son vœu au troisième acte sera plus modeste : "Je veux dormir", c'est-à-dire mourir et ce, dans un asile de fous. Un épilogue à la façon du "Don Giovanni" de Mozart viendra donner aux spectateurs la morale de l'histoire : "Tout le monde n'a pas une Trulove pour se sauver, chacun se rêve plus grand qu'il n'est …".
L'opéra, qui ressuscite les formes du passé, celles d'avant Wagner, avec ses ensembles vocaux, ses airs à reprises et da capo, ses récitatifs accompagnés au clavecin, convoque aussi les procédés de l'opérette, des musicals de Broadway ou du cinéma américain de l'âge d'or. Loin de n'être qu'un inventaire de citations et un mauvais pastiche, tel qu'on lui en fait le reproche à sa création à Venise en 1951, Stravinski invente ici une forme rhapsodique qui relève du post-modernisme des années cinquante mais qui est aussi profondément originale avec son style inimitable : une orchestration coloriste, une écriture vocale raffinée, et bien-sûr un travail éminent de rythmicien.
Finalement ruiné, corrompu moralement et ne se sentant plus digne d'Ann Trulove qui ne l'a pas abandonné malgré ses errements, son vœu au troisième acte sera plus modeste : "Je veux dormir", c'est-à-dire mourir et ce, dans un asile de fous. Un épilogue à la façon du "Don Giovanni" de Mozart viendra donner aux spectateurs la morale de l'histoire : "Tout le monde n'a pas une Trulove pour se sauver, chacun se rêve plus grand qu'il n'est …".
L'opéra, qui ressuscite les formes du passé, celles d'avant Wagner, avec ses ensembles vocaux, ses airs à reprises et da capo, ses récitatifs accompagnés au clavecin, convoque aussi les procédés de l'opérette, des musicals de Broadway ou du cinéma américain de l'âge d'or. Loin de n'être qu'un inventaire de citations et un mauvais pastiche, tel qu'on lui en fait le reproche à sa création à Venise en 1951, Stravinski invente ici une forme rhapsodique qui relève du post-modernisme des années cinquante mais qui est aussi profondément originale avec son style inimitable : une orchestration coloriste, une écriture vocale raffinée, et bien-sûr un travail éminent de rythmicien.
Si la question qui traverse l'ouvrage en filigrane est bien celle des choix successifs malheureux des Muses pour Tom Rakewell/Stravinski, Simon Mc Burney a choisi un autre point de vue actualisant une intrigue censée se passer au XVIIIe siècle. Simplicité, ingéniosité et humour sont les maîtres-mots d'une lecture des plus intéressantes parce qu'elle propose au spectateur un miroir de notre condition contemporaine tout à fait en phase avec l'œuvre.
Nous serions tous des Tom Rakewell happés par les mirages produits par les excès de notre société capitaliste - une société du spectacle de surcroît. Les costumes de Christina Cunningham sont en partie les nôtres (costumes sombres et robes bourgeoises), les personnages (qui sortent du public au troisième acte) se filment avec un portable et ces images sont projetées sur le papier blanc dont sont faits les trois murs du plateau : idée géniale qui fait de la fiction imagière d'aspirations vite brisées le moteur de l'œuvre.
De travellings cinématographiques qui nous font suivre Tom et Nick de la campagne à la mégalopole moderne en projection d'images de chiffres de Wall Street virant au rouge pour signifier la ruine du héros ou du palais plein du bric-à-brac des souvenirs acquis par Baba la Turque pendant ses tournées, la proposition scénique enchante par son dynamisme, son inventivité et son humour so british - apparemment moins amère que le livret d'Auden.
Nous serions tous des Tom Rakewell happés par les mirages produits par les excès de notre société capitaliste - une société du spectacle de surcroît. Les costumes de Christina Cunningham sont en partie les nôtres (costumes sombres et robes bourgeoises), les personnages (qui sortent du public au troisième acte) se filment avec un portable et ces images sont projetées sur le papier blanc dont sont faits les trois murs du plateau : idée géniale qui fait de la fiction imagière d'aspirations vite brisées le moteur de l'œuvre.
De travellings cinématographiques qui nous font suivre Tom et Nick de la campagne à la mégalopole moderne en projection d'images de chiffres de Wall Street virant au rouge pour signifier la ruine du héros ou du palais plein du bric-à-brac des souvenirs acquis par Baba la Turque pendant ses tournées, la proposition scénique enchante par son dynamisme, son inventivité et son humour so british - apparemment moins amère que le livret d'Auden.
L'amertume est pourtant bien là : le plateau tout blanc du début du premier acte fait penser à une chambre d'asile et nous savons que la carrière de Tom ne pourra que le renvoyer à cette prison mentale et à la mort au terme de sa course vaine.
La distribution est homogène, jeune, talentueuse. Tom Rakewell est, sous les traits du ténor américain Paul Appleby, un quidam torturé et naïf qui ne peut que se repentir de suivre aveuglément ses appétits et son infernal mentor, une sorte de trader, prestement incarné par le baryton-basse Kyle Ketelsen. La soprano américaine Julia Bullock donne sensibilité et esprit à sa Ann, personnage qui n'est donc pas ici l'ange de convention vu ailleurs. Autre idée superbe : l'épouse de Tom, Baba la Turque, n'est plus une femme à (fausse) barbe chantée par une mezzo, mais ici une star transformiste chantée par un contre-ténor - une vision plus actuelle.
Si l'alchimie n'a pas semblé prendre entre le chef Eivind Gullberg Jensen (en remplacement de Daniel Harding) et l'Orchestre de Paris dont la prestation se révèle assez décevante en termes de rythme et parfois d'expressivité (ce n'est pas faute de posséder d'incroyables solistes dans ses rangs), le chœur English Voices a ravi tant pour son engagement que pour son talent comique irrésistible.
La distribution est homogène, jeune, talentueuse. Tom Rakewell est, sous les traits du ténor américain Paul Appleby, un quidam torturé et naïf qui ne peut que se repentir de suivre aveuglément ses appétits et son infernal mentor, une sorte de trader, prestement incarné par le baryton-basse Kyle Ketelsen. La soprano américaine Julia Bullock donne sensibilité et esprit à sa Ann, personnage qui n'est donc pas ici l'ange de convention vu ailleurs. Autre idée superbe : l'épouse de Tom, Baba la Turque, n'est plus une femme à (fausse) barbe chantée par une mezzo, mais ici une star transformiste chantée par un contre-ténor - une vision plus actuelle.
Si l'alchimie n'a pas semblé prendre entre le chef Eivind Gullberg Jensen (en remplacement de Daniel Harding) et l'Orchestre de Paris dont la prestation se révèle assez décevante en termes de rythme et parfois d'expressivité (ce n'est pas faute de posséder d'incroyables solistes dans ses rangs), le chœur English Voices a ravi tant pour son engagement que pour son talent comique irrésistible.
Jusqu'au 18 juillet 2017.
Théâtre de l'Archevêché.
Place de l'Ancien Archevêché, Aix-en-Provence.
Tél. : 08 20 922 923.
>> festival-aix.com
"The Rake's Progress" (1951).
Opéra en trois actes et un épilogue.
Musique de Igor Stravinski.
Livret en anglais de W.H. Auden et C.S. Kallman.
Durée : 2 h 50 avec entracte.
Eivind Gullberg Jensen, direction musicale.
Simon Mc Burney, mise en scène.
Gerard Mc Burney, dramaturgie.
Théâtre de l'Archevêché.
Place de l'Ancien Archevêché, Aix-en-Provence.
Tél. : 08 20 922 923.
>> festival-aix.com
"The Rake's Progress" (1951).
Opéra en trois actes et un épilogue.
Musique de Igor Stravinski.
Livret en anglais de W.H. Auden et C.S. Kallman.
Durée : 2 h 50 avec entracte.
Eivind Gullberg Jensen, direction musicale.
Simon Mc Burney, mise en scène.
Gerard Mc Burney, dramaturgie.
Michael Levine, décors.
Christina Cunningham, costumes.
Paul Anderson, lumières.
Will Duke, vidéo.
Julia Bullock, Ann Trulove.
Paul Appleby, Tom Rakewell.
Kyle Ketelsen, Nick Shadow.
David Pittsinger, Trulove.
Hilary Summers, Mother Goose.
Andrew Watts, Baba la Turque.
Alan Oke, Sellem.
Evan Hughes, Keeper of the Madhouse, N. Shadow 2.
English Voices.
Tim Brown, Chef de chœur.
Orchestre de Paris.
Christina Cunningham, costumes.
Paul Anderson, lumières.
Will Duke, vidéo.
Julia Bullock, Ann Trulove.
Paul Appleby, Tom Rakewell.
Kyle Ketelsen, Nick Shadow.
David Pittsinger, Trulove.
Hilary Summers, Mother Goose.
Andrew Watts, Baba la Turque.
Alan Oke, Sellem.
Evan Hughes, Keeper of the Madhouse, N. Shadow 2.
English Voices.
Tim Brown, Chef de chœur.
Orchestre de Paris.