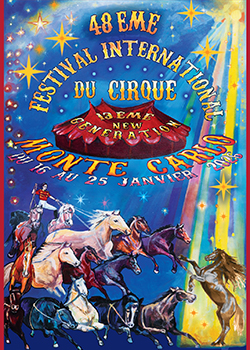En décembre 1935, Arthur Honegger, membre à sa façon affranchie du Groupe des Six, termine la partition d'un oratorio qui lui a été commandé par Ida Rubinstein - éminente figure de l'avant-garde de l'époque - sur un sujet qu'elle lui a suggéré. Ce sera Jeanne d'Arc, un personnage inspirant pour celle qui vient de découvrir le genre du mystère médiéval.
Honegger s'est donc adressé à Paul Claudel - une évidence - pour le livret. Malgré son refus initial de s'emparer d'un tel personnage et de sa légende dorée, le poète écrit le livret en onze jours, en versets où respire le fameux "spiritus" : cet esprit et ce souffle divins qui se communiquent à l'acteur dans son théâtre. Le sujet en sera l'avènement de la grâce après l'acceptation du martyre.
Claudel choisit d'évoquer la Passion de Jeanne en onze tableaux (le prologue sera rajouté en 1945) ; Jeanne d'Arc sur le bûcher (en 1431) en voit défiler les stations et des épisodes de sa vie dans un ordre chronologique inversé, du procès à l'enfance. C'est sur le livre que tient Frère Dominique (un saint qui a vécu au XIIIe siècle) et au rythme des voix des acteurs de son procès comme des saints, que se fait cette récapitulation jusqu'à la mort de celle qui sera canonisée au début du XXe siècle.
Honegger s'est donc adressé à Paul Claudel - une évidence - pour le livret. Malgré son refus initial de s'emparer d'un tel personnage et de sa légende dorée, le poète écrit le livret en onze jours, en versets où respire le fameux "spiritus" : cet esprit et ce souffle divins qui se communiquent à l'acteur dans son théâtre. Le sujet en sera l'avènement de la grâce après l'acceptation du martyre.
Claudel choisit d'évoquer la Passion de Jeanne en onze tableaux (le prologue sera rajouté en 1945) ; Jeanne d'Arc sur le bûcher (en 1431) en voit défiler les stations et des épisodes de sa vie dans un ordre chronologique inversé, du procès à l'enfance. C'est sur le livre que tient Frère Dominique (un saint qui a vécu au XIIIe siècle) et au rythme des voix des acteurs de son procès comme des saints, que se fait cette récapitulation jusqu'à la mort de celle qui sera canonisée au début du XXe siècle.
Honegger développe dans son "oratorio dramatique" (qui peut donc être mis en scène) sa formule rêvée d'un renouveau lyrique mêlant rôles parlés, danseurs, chanteurs, chœurs et un orchestre dominé par les vents et les bois (dont deux saxophones) et l'usage du piano, du célesta, des ondes Martenot.
La partition fait coexister (et parfois marie) musique populaire, carnavalesque même et un lyrisme mystique ou grandiose (Honegger, ce grand admirateur de Bach). Mêlant tous les arts, cette fresque digne d'un peintre primitif interroge ainsi chaque metteur en scène sur les places respectives du chant et du jeu, dans la tradition du souffle poétique claudélien. Auteur, metteur en scène et quasi plasticien, on comprend ce qui a pu plaire à Romeo Castellucci dans ce nouveau défi.
Las, si l'interprétation musicale, tant vocale qu'instrumentale, se révèle envoûtante dans ses jeux de lumières et d'ombres, équilibrée entre parodie et tragédie, la proposition du metteur en scène italien se révèle plus risquée, pour ne pas dire décalée quant aux enjeux de l'œuvre.
La partition fait coexister (et parfois marie) musique populaire, carnavalesque même et un lyrisme mystique ou grandiose (Honegger, ce grand admirateur de Bach). Mêlant tous les arts, cette fresque digne d'un peintre primitif interroge ainsi chaque metteur en scène sur les places respectives du chant et du jeu, dans la tradition du souffle poétique claudélien. Auteur, metteur en scène et quasi plasticien, on comprend ce qui a pu plaire à Romeo Castellucci dans ce nouveau défi.
Las, si l'interprétation musicale, tant vocale qu'instrumentale, se révèle envoûtante dans ses jeux de lumières et d'ombres, équilibrée entre parodie et tragédie, la proposition du metteur en scène italien se révèle plus risquée, pour ne pas dire décalée quant aux enjeux de l'œuvre.
Dans cette radicale et implacable destruction du plateau (une salle de classe sous la IIIe République) sur lequel un homme de peine entend des voix et se défait, le temps d'endosser les oripeaux du personnage de Jeanne, le spectateur est invité à oublier tout ce qu'il croit savoir sur la sainte - que cette lecture s'ingénie à déconstruire sous nos yeux avec rage mais aussi pas mal de naïveté. De là un prologue avant le prologue, interminable, où (l'extraordinaire) Audrey Bonnet déguisée en homme de ménage déménage tables et chaises de ladite classe avec force han(s) - et grincements hideux. Le spectacle rallonge d'ailleurs l'œuvre d'une bonne demi-heure.
Quelques tableaux émergent, d'une beauté indéniable, mais la parodie recouvre tout, non sans autocitations et tics de Castellucci. Son pouvoir corrosif nous entraînant avec une réelle efficacité dans les limbes de la déréliction jusqu'à cette scène où l'actrice (qui subit plus qu'on ne saurait dire d'assez horribles épreuves) après avoir arraché plusieurs revêtements de la scène, s'enterre. Aucune grâce ici, et pas d'esprit divin (ou non). Pourquoi pas ? Mais à quoi bon ? Sauf à se dire que travailler contre l'œuvre est un art en soi… mais ô combien dépassé ? Plus performance que mise en scène lyrique, ce travail, qui fonctionnait très bien avec Schoenberg*, est assez décevant ici.
*Romeo Castellucci a mis en scène brillamment "Moïse et Aaron" à l'Opéra de Paris en 2015.
Quelques tableaux émergent, d'une beauté indéniable, mais la parodie recouvre tout, non sans autocitations et tics de Castellucci. Son pouvoir corrosif nous entraînant avec une réelle efficacité dans les limbes de la déréliction jusqu'à cette scène où l'actrice (qui subit plus qu'on ne saurait dire d'assez horribles épreuves) après avoir arraché plusieurs revêtements de la scène, s'enterre. Aucune grâce ici, et pas d'esprit divin (ou non). Pourquoi pas ? Mais à quoi bon ? Sauf à se dire que travailler contre l'œuvre est un art en soi… mais ô combien dépassé ? Plus performance que mise en scène lyrique, ce travail, qui fonctionnait très bien avec Schoenberg*, est assez décevant ici.
*Romeo Castellucci a mis en scène brillamment "Moïse et Aaron" à l'Opéra de Paris en 2015.
Prochaines dates
Mardi 31 janvier, jeudi 2 février, vendredi 3 février 2017 à 20 h.
Opéra de Lyon.
Place de la Comédie, Lyon.
Tél. : 04 69 85 54 54.
>> opera-lyon.com
"Jeanne d’Arc au bûcher" (1938).
Oratorio dramatique en 11 scènes avec prologue.
Musique d'Arthur Honegger.
Livret de Paul Claudel.
En français.
Durée : 1 h 30 environ.
Direction musicale : Kazushi Ono.
Mardi 31 janvier, jeudi 2 février, vendredi 3 février 2017 à 20 h.
Opéra de Lyon.
Place de la Comédie, Lyon.
Tél. : 04 69 85 54 54.
>> opera-lyon.com
"Jeanne d’Arc au bûcher" (1938).
Oratorio dramatique en 11 scènes avec prologue.
Musique d'Arthur Honegger.
Livret de Paul Claudel.
En français.
Durée : 1 h 30 environ.
Direction musicale : Kazushi Ono.
Mise en scène, décors, costumes et lumières : Romeo Castellucci.
Dramaturgie : Piersandra Di Matteo.
Collaboratrice artistique : Silvia Costa.
Audrey Bonnet, Jeanne d'Arc.
Denis Podalydès, Frère Dominique.
Ilse Eerens, La Vierge.
Valentine Lemercier, Marguerite.
Marie Karall, Catherine.
Jean-Noël Briend, ténor solo (une voix, Porcus, 1er Héraut, Le Clerc).
Sophie Lou, Pécus.
Didier Laval, récitant.
Louka Petit-Taborelli, récitant.
Participation de Istvan Zimmermann et Giovanna Amoroso, Plastikart Studio.
Orchestre, Chœurs et Maîtrise de l’Opéra de Lyon.
Philip White, Chef des chœurs.
Karine Locatelli, Chef de chœur de la Maîtrise.
Dramaturgie : Piersandra Di Matteo.
Collaboratrice artistique : Silvia Costa.
Audrey Bonnet, Jeanne d'Arc.
Denis Podalydès, Frère Dominique.
Ilse Eerens, La Vierge.
Valentine Lemercier, Marguerite.
Marie Karall, Catherine.
Jean-Noël Briend, ténor solo (une voix, Porcus, 1er Héraut, Le Clerc).
Sophie Lou, Pécus.
Didier Laval, récitant.
Louka Petit-Taborelli, récitant.
Participation de Istvan Zimmermann et Giovanna Amoroso, Plastikart Studio.
Orchestre, Chœurs et Maîtrise de l’Opéra de Lyon.
Philip White, Chef des chœurs.
Karine Locatelli, Chef de chœur de la Maîtrise.