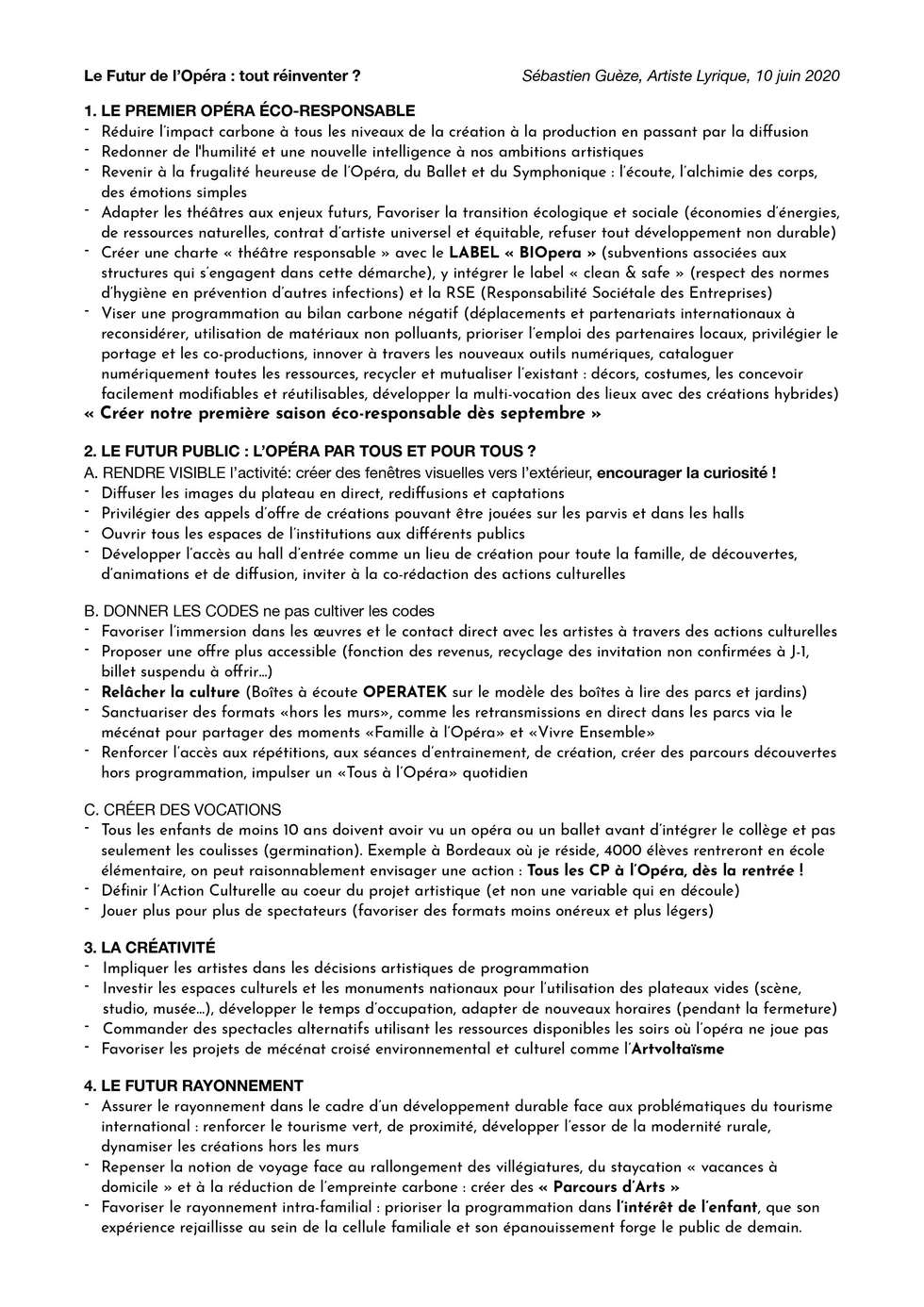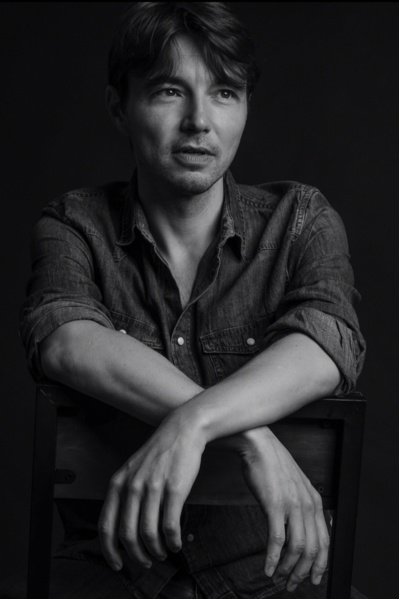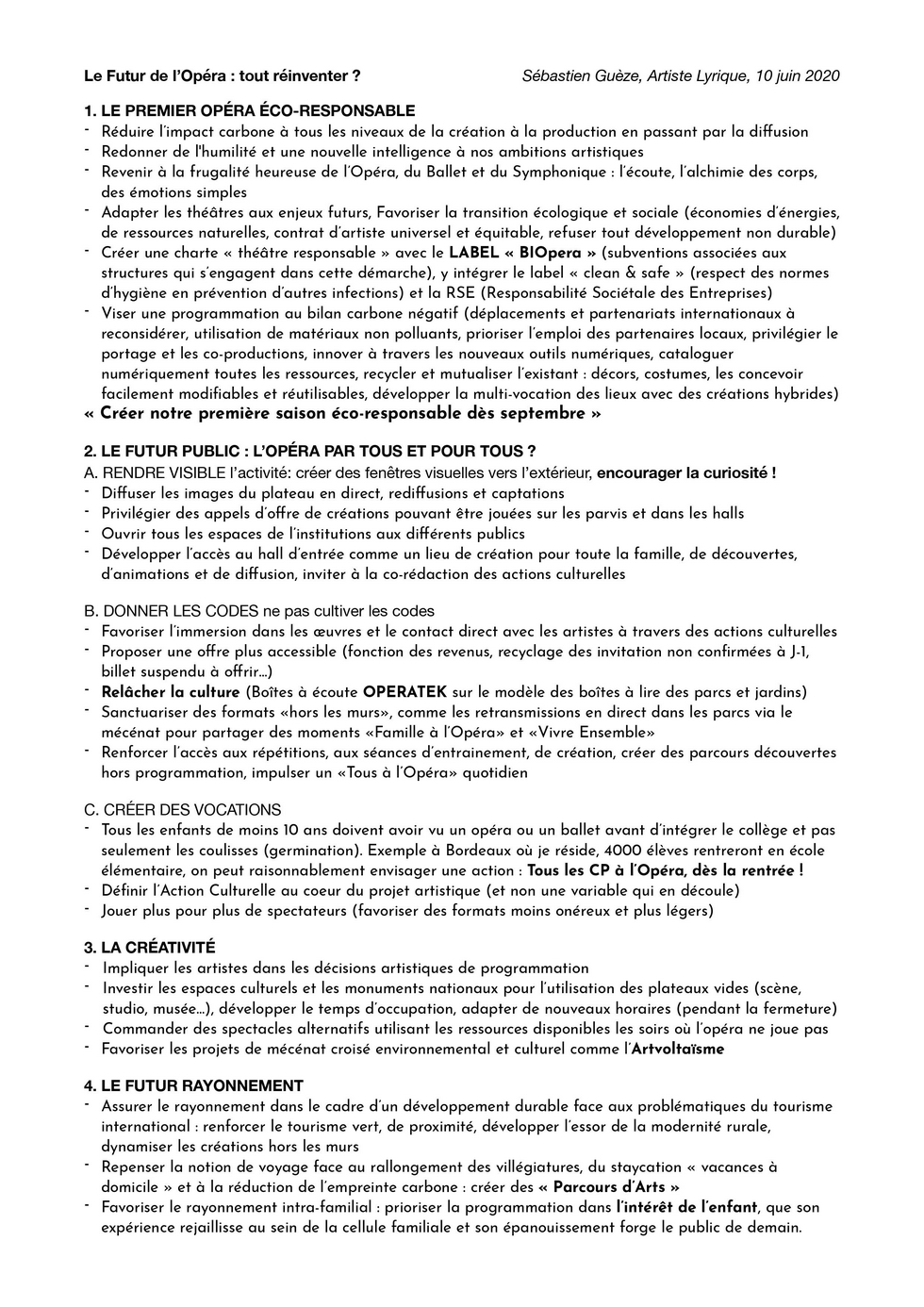Christine Ducq - Comment s'est passé ce confinement ? Où étiez-vous ?
Sébastien Guèze - J'étais chez moi à Bordeaux où je réside depuis de nombreuses années et sous le choc de cet événement. Au lendemain de l'annonce présidentielle, j'étais à l'Opéra de Marseille sur scène en pleine répétition avec Ermonela Jaho, une semaine avant la première d'"Adriana Lecouvreur", quand Maurice Xiberras, le directeur de la maison, est venu sur scène nous annoncer qu'il fallait rentrer à la maison.
Nous avons vraiment vécu un moment inédit. Je ne l'oublierai jamais. Alors que je revenais au théâtre chercher une partition que j'avais oubliée dans ma loge, j'ai eu l'expérience de ce spectacle terrible d'un théâtre plongé dans le noir, dans un silence imposant. Une expérience aussi fascinante que triste. C'était stupéfiant !
Bien sûr cette vague épidémique a emporté trop de personnes, une tragédie autrement plus effrayante. Néanmoins, voir la culture à l'arrêt symbolisée par ce théâtre dans les ténèbres, et nous les chanteurs réduits au silence… Ce moment m'obsède.
Il me faut dire que, dans l'adversité, des directeurs et des responsables de municipalités ont été héroïques et se sont vraiment révélés. Notamment Maurice Xiberras qui s'est battu le jour même pour que les artistes de l'Opéra de Marseille soient soutenus. Je tiens à le souligner car cette réaction est loin d'avoir été majoritaire dans nos opéras et théâtres. À Marseille, nous avons eu cette chance d'être payés intégralement comme si le spectacle avait eu lieu.
Sébastien Guèze - J'étais chez moi à Bordeaux où je réside depuis de nombreuses années et sous le choc de cet événement. Au lendemain de l'annonce présidentielle, j'étais à l'Opéra de Marseille sur scène en pleine répétition avec Ermonela Jaho, une semaine avant la première d'"Adriana Lecouvreur", quand Maurice Xiberras, le directeur de la maison, est venu sur scène nous annoncer qu'il fallait rentrer à la maison.
Nous avons vraiment vécu un moment inédit. Je ne l'oublierai jamais. Alors que je revenais au théâtre chercher une partition que j'avais oubliée dans ma loge, j'ai eu l'expérience de ce spectacle terrible d'un théâtre plongé dans le noir, dans un silence imposant. Une expérience aussi fascinante que triste. C'était stupéfiant !
Bien sûr cette vague épidémique a emporté trop de personnes, une tragédie autrement plus effrayante. Néanmoins, voir la culture à l'arrêt symbolisée par ce théâtre dans les ténèbres, et nous les chanteurs réduits au silence… Ce moment m'obsède.
Il me faut dire que, dans l'adversité, des directeurs et des responsables de municipalités ont été héroïques et se sont vraiment révélés. Notamment Maurice Xiberras qui s'est battu le jour même pour que les artistes de l'Opéra de Marseille soient soutenus. Je tiens à le souligner car cette réaction est loin d'avoir été majoritaire dans nos opéras et théâtres. À Marseille, nous avons eu cette chance d'être payés intégralement comme si le spectacle avait eu lieu.
En discutant avec mes collègues chanteurs, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas partout.
Plus grave, nous avons tous connu une vague d'annulations sans précédent pour tous nos contrats en cours et futurs. À la suite d'échanges entre chanteurs, nous avons décidé de créer une plateforme de discussion et d'écoute sur ce qui nous arrivait. Ce qui est à l'origine de la création de notre association UNISSON, qui comprend à ce jour plus de 300 artistes lyriques internationaux. Ce qui témoigne d'un bel élan de fraternité entre nous, chanteurs, d'habitude très isolés, de vrais loups solitaires !
Tout étant à l'arrêt, se posait la question : que faire ?
De mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, d'annulations en annulations et ce jusqu'en 2023 parfois, il fallait réagir. Moi-même, mes contrats sont annulés jusqu'en octobre. Je ne sais absolument pas si je pourrais chanter Don José dans "Carmen" à Leipzig en novembre. Tout dépendra de la situation sanitaire, de l'espace de l'orchestre en fosse, de celui réservé au chœur et aux solistes sur scène, de l'accueil du public. Bref, nous en sommes tous là.
Les théâtres n'ont aucune visibilité et doivent naviguer à vue. Je ne leur lance pas la pierre. Bien que certains, affirmant qu'ils n'ont pas les moyens de dédommager les artistes correctement (ou leur contrat de cession), financent pourtant en même temps des manifestations numérisées. Et ce, parfois avec de nouveaux invités, sans même l'avoir proposé aux premiers artistes initialement engagés. Cela trouble le message au sein de notre profession.
Pour le public, ces exemples suscitent l'interrogation sur l'usage des fonds en cas de demande de non-remboursement des billets. Ces demandes par les théâtres se sont faites parfois en sous-entendant qu'on rémunérerait complètement les artistes, comme si les productions avaient été données. Chaque jour, je reçois ce type de nouvelles de la part de mes collègues et je ne trouve pas de réponse.
Peut-être les structures devraient-t-elles communiquer davantage sur ces chiffres (pourcentage de billetterie, perte de mécénat et autres) : quel budget a-t-il été ainsi perdu ou économisé ? Elles devraient les afficher quand elles rémunèrent pleinement tous les contrats (techniciens, danseurs, chanteurs, maquilleurs, etc.), cela ferait la fierté du public.
Plus grave, nous avons tous connu une vague d'annulations sans précédent pour tous nos contrats en cours et futurs. À la suite d'échanges entre chanteurs, nous avons décidé de créer une plateforme de discussion et d'écoute sur ce qui nous arrivait. Ce qui est à l'origine de la création de notre association UNISSON, qui comprend à ce jour plus de 300 artistes lyriques internationaux. Ce qui témoigne d'un bel élan de fraternité entre nous, chanteurs, d'habitude très isolés, de vrais loups solitaires !
Tout étant à l'arrêt, se posait la question : que faire ?
De mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, d'annulations en annulations et ce jusqu'en 2023 parfois, il fallait réagir. Moi-même, mes contrats sont annulés jusqu'en octobre. Je ne sais absolument pas si je pourrais chanter Don José dans "Carmen" à Leipzig en novembre. Tout dépendra de la situation sanitaire, de l'espace de l'orchestre en fosse, de celui réservé au chœur et aux solistes sur scène, de l'accueil du public. Bref, nous en sommes tous là.
Les théâtres n'ont aucune visibilité et doivent naviguer à vue. Je ne leur lance pas la pierre. Bien que certains, affirmant qu'ils n'ont pas les moyens de dédommager les artistes correctement (ou leur contrat de cession), financent pourtant en même temps des manifestations numérisées. Et ce, parfois avec de nouveaux invités, sans même l'avoir proposé aux premiers artistes initialement engagés. Cela trouble le message au sein de notre profession.
Pour le public, ces exemples suscitent l'interrogation sur l'usage des fonds en cas de demande de non-remboursement des billets. Ces demandes par les théâtres se sont faites parfois en sous-entendant qu'on rémunérerait complètement les artistes, comme si les productions avaient été données. Chaque jour, je reçois ce type de nouvelles de la part de mes collègues et je ne trouve pas de réponse.
Peut-être les structures devraient-t-elles communiquer davantage sur ces chiffres (pourcentage de billetterie, perte de mécénat et autres) : quel budget a-t-il été ainsi perdu ou économisé ? Elles devraient les afficher quand elles rémunèrent pleinement tous les contrats (techniciens, danseurs, chanteurs, maquilleurs, etc.), cela ferait la fierté du public.
Que se passe-t-il pour vous en cas d'annulation ?
S. G. - Nous sommes sous contrats, mais pendant cette crise, nous avons pris conscience qu'ils n'étaient pas si contraignants, voire plutôt fragiles d'un point de vue juridique. Pour le dire vite, nous ne sommes guère protégés, et ce, sur un grand nombre de points. Chaque théâtre a ses clauses, selon la collectivité territoriale dont il dépend et selon ses usages. Or il a été très difficile de définir le cadre dans lequel nous nous situions. Étions-nous dans un cas de force majeure, prévoyant l'absence d'indemnités, comme le stipulent nos contrats ? Mais alors cette situation était contraire aux dispositifs mis en place par le gouvernement (chômage partiel, fonds divers).
En fait nous n'étions pas protégés dans cette situation précise de confinement. Les directives de l'État invitaient les théâtres à honorer les contrats mais, ce, sans caractère obligatoire. Le ministère, en effet, peut recommander mais non contraindre.
Il a manqué un cap et un cadre général dans la façon dont les collègues ont été traités. C'est ainsi qu'une minorité de directeurs héroïques comme à Marseille ont honoré 100 % des contrats. Une bon nombre d'institutions lyriques ne le faisant qu'à hauteur de 30 %, de 20 %, voire pas du tout !
Ces disparités existent également en Europe : un soutien massif des artistes en Allemagne ; et en Italie, en Espagne, par exemple, des acteurs souffrant énormément. En France, certains artistes ont pu bénéficier de l'assurance chômage, quoique un grand nombre d'entre eux ne puissent en bénéficier - car beaucoup vivent dans une grande précarité.
Je ne doute pas que le Ministère de la Culture y travaille en ce moment même.
Même en France, peu ou tardivement, trop peu d'institutions ont réagi en se disant que nous étions, nous les chanteurs, danseurs, instrumentistes, techniciens, l'essence de ce métier, qu'elles vivent grâce aux artistes sur scène et pas l'inverse. Tous les salaires de la filière doivent être pérennes pour traverser ce désert - pas uniquement ceux des emplois fixes.
S. G. - Nous sommes sous contrats, mais pendant cette crise, nous avons pris conscience qu'ils n'étaient pas si contraignants, voire plutôt fragiles d'un point de vue juridique. Pour le dire vite, nous ne sommes guère protégés, et ce, sur un grand nombre de points. Chaque théâtre a ses clauses, selon la collectivité territoriale dont il dépend et selon ses usages. Or il a été très difficile de définir le cadre dans lequel nous nous situions. Étions-nous dans un cas de force majeure, prévoyant l'absence d'indemnités, comme le stipulent nos contrats ? Mais alors cette situation était contraire aux dispositifs mis en place par le gouvernement (chômage partiel, fonds divers).
En fait nous n'étions pas protégés dans cette situation précise de confinement. Les directives de l'État invitaient les théâtres à honorer les contrats mais, ce, sans caractère obligatoire. Le ministère, en effet, peut recommander mais non contraindre.
Il a manqué un cap et un cadre général dans la façon dont les collègues ont été traités. C'est ainsi qu'une minorité de directeurs héroïques comme à Marseille ont honoré 100 % des contrats. Une bon nombre d'institutions lyriques ne le faisant qu'à hauteur de 30 %, de 20 %, voire pas du tout !
Ces disparités existent également en Europe : un soutien massif des artistes en Allemagne ; et en Italie, en Espagne, par exemple, des acteurs souffrant énormément. En France, certains artistes ont pu bénéficier de l'assurance chômage, quoique un grand nombre d'entre eux ne puissent en bénéficier - car beaucoup vivent dans une grande précarité.
Je ne doute pas que le Ministère de la Culture y travaille en ce moment même.
Même en France, peu ou tardivement, trop peu d'institutions ont réagi en se disant que nous étions, nous les chanteurs, danseurs, instrumentistes, techniciens, l'essence de ce métier, qu'elles vivent grâce aux artistes sur scène et pas l'inverse. Tous les salaires de la filière doivent être pérennes pour traverser ce désert - pas uniquement ceux des emplois fixes.
C'est beaucoup d'angoisse pour nos chanteurs ?
S. G. - C'est qu'en outre, nous nous apercevons que tout reprend sauf la culture, depuis quelques semaines. Cela nous interroge. Tous les Français ont repris le travail, il y a du monde dans les trains, dans les métros. Dès aujourd'hui, les spectateurs retourneront dans les cinémas et même dans les parcs à thèmes. En ce qui concerne le spectacle, on ne sait toujours pas si au mois de septembre les théâtres vont pouvoir ouvrir. Si on pourra chanter normalement sur scène, jouer dans la fosse, et dans quelles proportions on va pouvoir accueillir le public (jauge réduite ou normale). Produire un grand opéra comme "Carmen" ou "Aïda" demande plusieurs mois de travail. Comment s'organiser sans visibilité précise, sans date de reprise sans conditions définies ? Tous les acteurs du monde culturel se sentent aujourd'hui les derniers de cordée, pour le dire franchement. Je tire le signal d'alarme !
À un moment où des discours inquiétants de certains directeurs - et pas des moindres - commencent à se tenir sur le poids des "charges" que représentent les cotisations sociales des salaires des chanteurs et musiciens français.
Nous voilà lancés dans une compétition mortifère avec nos collègues étrangers. Une petite musique entêtante est en train de s'imposer, sur les sacrifices que nous, les artistes, devrions faire sur nos cachets. Mais c'est déjà le cas depuis des années et je pense aux jeunes chanteurs qui arrivent dans ce métier. Jusqu'où ce discours va-t-il nous entraîner ?
Le problème est là : la reconnaissance du travail accompli. Quand nous arrivons aux premières répétitions d'un opéra, nous sommes engagés par contrat à posséder parfaitement notre rôle. Ce qui induit un travail colossal en amont et le coût de cet apprentissage représente un vrai budget. Nous devons nous loger. Nous avons un agent, parfois un comptable, un pianiste et un prof de chant à rétribuer. Nous passons des heures à mémoriser un rôle et à nous entraîner. Tout ce travail est indemnisé par un cachet officiellement donné pour deux heures de musique par soirée. Le rêve que nous offrons a un prix : c'est comme lorsqu'on l'on vibre dans une finale avec des athlètes qui s'entraînent toute l'année.
Vous attendez donc impatiemment un plan clair pour la réouverture des théâtres ?
S. G. - C'est qu'en outre, nous nous apercevons que tout reprend sauf la culture, depuis quelques semaines. Cela nous interroge. Tous les Français ont repris le travail, il y a du monde dans les trains, dans les métros. Dès aujourd'hui, les spectateurs retourneront dans les cinémas et même dans les parcs à thèmes. En ce qui concerne le spectacle, on ne sait toujours pas si au mois de septembre les théâtres vont pouvoir ouvrir. Si on pourra chanter normalement sur scène, jouer dans la fosse, et dans quelles proportions on va pouvoir accueillir le public (jauge réduite ou normale). Produire un grand opéra comme "Carmen" ou "Aïda" demande plusieurs mois de travail. Comment s'organiser sans visibilité précise, sans date de reprise sans conditions définies ? Tous les acteurs du monde culturel se sentent aujourd'hui les derniers de cordée, pour le dire franchement. Je tire le signal d'alarme !
À un moment où des discours inquiétants de certains directeurs - et pas des moindres - commencent à se tenir sur le poids des "charges" que représentent les cotisations sociales des salaires des chanteurs et musiciens français.
Nous voilà lancés dans une compétition mortifère avec nos collègues étrangers. Une petite musique entêtante est en train de s'imposer, sur les sacrifices que nous, les artistes, devrions faire sur nos cachets. Mais c'est déjà le cas depuis des années et je pense aux jeunes chanteurs qui arrivent dans ce métier. Jusqu'où ce discours va-t-il nous entraîner ?
Le problème est là : la reconnaissance du travail accompli. Quand nous arrivons aux premières répétitions d'un opéra, nous sommes engagés par contrat à posséder parfaitement notre rôle. Ce qui induit un travail colossal en amont et le coût de cet apprentissage représente un vrai budget. Nous devons nous loger. Nous avons un agent, parfois un comptable, un pianiste et un prof de chant à rétribuer. Nous passons des heures à mémoriser un rôle et à nous entraîner. Tout ce travail est indemnisé par un cachet officiellement donné pour deux heures de musique par soirée. Le rêve que nous offrons a un prix : c'est comme lorsqu'on l'on vibre dans une finale avec des athlètes qui s'entraînent toute l'année.
Vous attendez donc impatiemment un plan clair pour la réouverture des théâtres ?
S. G. - Certes. Mais un certain nombre de questions se posent pour l'avenir de l'opéra. Les questions dont il faut se saisir suite à cette crise. Par exemple : l'opéra ne doit-il pas se réinventer ?
Pendant que nous étions confinés dans ces villes désertées où la nature, les animaux reprenaient leur droit dans cette société à l'arrêt, nous avons tous réfléchi à une société différente.
L'opéra doit aussi se réinventer, peut-être dans une voie plus écologique, plus responsable.
À titre personnel, je m'interroge : ne faudrait-il pas imaginer qu'il existe des contrats obéissant à une législation européenne unique pour les artistes - pour éviter toute compétition déloyale ? Voire imaginer un contrat universel et équitable sur une base semblable pour tous, des clauses d'annulation si une autre crise devait advenir. Imaginons aussi des cotisations égales ou le versement d'arrhes à la signature du contrat.
Je le répète, la grande problématique actuelle c'est que l'heure de créer nos premiers opéras éco-responsables est venue. En tout cas, ces questions majeures doivent être posées et on doit faire appel aux artistes pour y réfléchir. Je développe actuellement une réflexion sur ce sujet avec des dizaines de pages d'idées dont j'ai publié un résumé sur les réseaux sociaux.
Je suis un jeune père et, en tant que citoyen du monde et artiste créatif, je me dois de m'engager. Quel monde doit connaître mon fils, quel modèle d'Opéra ? Ce dernier doit-il aller vers plus de frugalité ou de simplicité ? Moi qui chante dans le monde entier, je suis le premier à devoir me remettre en question.
Le texte publié par Sébastien Guèze, qui tient en quatre points très développés, est à lire ci-dessous :
Pendant que nous étions confinés dans ces villes désertées où la nature, les animaux reprenaient leur droit dans cette société à l'arrêt, nous avons tous réfléchi à une société différente.
L'opéra doit aussi se réinventer, peut-être dans une voie plus écologique, plus responsable.
À titre personnel, je m'interroge : ne faudrait-il pas imaginer qu'il existe des contrats obéissant à une législation européenne unique pour les artistes - pour éviter toute compétition déloyale ? Voire imaginer un contrat universel et équitable sur une base semblable pour tous, des clauses d'annulation si une autre crise devait advenir. Imaginons aussi des cotisations égales ou le versement d'arrhes à la signature du contrat.
Je le répète, la grande problématique actuelle c'est que l'heure de créer nos premiers opéras éco-responsables est venue. En tout cas, ces questions majeures doivent être posées et on doit faire appel aux artistes pour y réfléchir. Je développe actuellement une réflexion sur ce sujet avec des dizaines de pages d'idées dont j'ai publié un résumé sur les réseaux sociaux.
Je suis un jeune père et, en tant que citoyen du monde et artiste créatif, je me dois de m'engager. Quel monde doit connaître mon fils, quel modèle d'Opéra ? Ce dernier doit-il aller vers plus de frugalité ou de simplicité ? Moi qui chante dans le monde entier, je suis le premier à devoir me remettre en question.
Le texte publié par Sébastien Guèze, qui tient en quatre points très développés, est à lire ci-dessous :